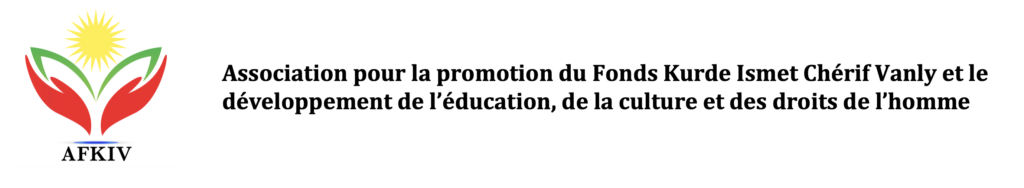Le 9 octobre la Turquie a lancé sa troisième offensive militaire, baptisée « la source de la paix », au Nord de la Syrie, dans cette région que les Kurdes nomment le Rojava. Après « le bouclier d’Euphrate » au début de 2017, puis « le rameau d’olivier » en janvier 2018, qui s’est terminée avec l’occupation de l’enclave d’Afrin, les forces aériennes et terrestres turques visent cette fois-ci des régions de Syrie tenues par les milices kurdes, arabes et assyro-chaldéennes qui forment les Forces démocratiques syriennes (FDS), majoritairement kurdes. Considérées comme « terroristes » par le régime de Recep Tayyip Erdogan, mais alliées des Occidentaux car elles ont mené la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique (EI), les FDS ont livré de violents combats contre les troupes turques et leurs supplétifs syriens au Nord-Est du pays. Plus de 300’000 personnes ont dû quitter leur habitation, et les autorités locales annoncent à ce jour la mort de plus de 250 civil·e·s sous les bombardements de l’armée turque.
Après les génocides arméniens et assyro-chaldéens de 1914 et 1915, les revendications autonomistes kurdes sont devenues le principal problème au cœur de la « république turque, homogène et unitaire ». Les Kurdes, qui représentent 24% de la population de la Turquie, sont considérés comme un groupe à assimiler par la force, sinon à exterminer purement et simplement. Depuis la création de la République turque en 1923, toutes leurs revendications ont été qualifiées de « terroristes », quel que soit leur caractère politique : indépendantiste, fédéraliste ou civique. Les gouvernements successifs à Ankara ont considéré toutes leurs demandes politiques comme un problème de sécurité nationale, y compris au-delà des frontières comme au Kurdistan iranien, irakien et syrien. L’armée turque y a donc mené des opérations militaires, généralement en toute illégalité. Toute organisation kurde autonomiste ou indépendantiste revendiquant des droits politiques ou culturels est immédiatement considérée comme un danger pour la sécurité nationale et pour l’unité territoriale de la Turquie.
Les Kurdes n’existent plus
La répression contre les Kurdes est impitoyable. En avril 2019 par exemple, la représentation diplomatique turque au Japon exerce des pressions sur les autorités de ce pays à cause des cours en langue kurde organisés à l’Université de Tokyo des études étrangères (TUFS). En Turquie, huit député·e·s du HDP (Parti démocratique des peuples, pro-kurde) ainsi que 62 maires sont en prison, accusés de « propagande ou soutien au terrorisme ». En septembre 2017, lorsque le gouvernement régional du Kurdistan irakien a lancé le référendum d’indépendance, Erdogan a menacé de frapper Erbil, la capitale régionale. Il a finalement décidé d’imposer des sanctions économiques et a interrompu les liaisons aériennes. À ces différentes formes de répression, on pourrait encore ajouter d’innombrables exemples. La conclusion à tirer, c’est que le pouvoir turc refuse de tolérer la moindre organisation des populations kurdes, qu’elle soit politique, culturelle ou sociale.
Les ambitions néo-ottomanes de la Turquie
Les racines de cette kurdophobie institutionnalisée en Turquie se trouvent dans le Misak-i Milli (le serment national) du 28 janvier 1920, proclamé lors du dernier mandat du Parlement ottoman, qui a tracé les frontières du nouvel État turc. Selon ce pacte, la Turquie devait inclure la Thrace, le « vilayet » de Mossoul (y compris Kirkouk), Alep et, au Nord-Est, la ville actuelle de Batoumi (en Géorgie), et abandonner les anciennes provinces arabes. Le Misak-i Milli affirme également l’indivisibilité de la nation turque. Ce pacte devient par la suite la base du Traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923, puis de la proclamation de la république, le 29 octobre 1923. La Turquie est alors présentée comme un État unitaire et une nation homogène. Mais ni les Ottomans, ni leur successeurs kémalistes n’ont pu digérer la perte de ces territoires. Les gouvernements successifs, de gauche ou de droite, islamistes ou laïcs (nationalistes), ont toujours caressé l’ambition de récupérer un jour Kirkouk et Mossoul.
La république turque a été créée sur les ruines de l’Empire ottoman, mais aussi sur les cendres du génocide arménien et assyro-chaldéens de 1914-1915. Ces deux tragédies ont été suivies par les massacres kurdes de 1925 (suite à la révolte de Sheikh Said), puis par celui de Dersim en 1938, sans compter tous les autres… Alors que la Turquie croyait en avoir fini avec les minorités non musulmanes, elle s’est retrouvée face aux revendications indépendantistes ou autonomistes kurdes. L’État turc se considère comme une « nation unique, langue unique, religion unique et drapeau unique », ainsi que le répètent les manuels scolaires. Toute contestation contre ce principe unitaire, qu’il s’agisse de revendications démocratiques, pacifiques ou militaires, est immédiatement qualifiée de « terroriste ».
Au début de 1990, un leader libéral comme Turgut Özal a souvent utilisé, en particulier dans les moments de crise politique et économique, la rhétorique faisant de Kirkouk et Mossoul des parties de la Turquie. Aujourd’hui, c’est au tour d’Erdogan d’user du même stratagème. Il ravive ainsi les rêves islamo-nationalistes turcs de reprendre Kirkouk et Mossoul, deux villes situées au cœur de la région pétrolifère irakienne. Un des objectifs de l’occupation turque du Nord de la Syrie, est l’ambition, si un jour la conjoncture le permet, d’avancer jusqu’à la ville irakienne de Mossoul.
Président d’un pays plongé dans une profonde crise économique et politique, Recep Erdogan mène depuis le début de la guerre civile en Syrie, avec Devlet Bahçeli, son alliée ultra nationaliste du MHP (Parti du mouvement nationaliste), une stratégie du chaos afin de maintenir le pouvoir de l’AKP et du MHP. L’invasion turque en Syrie, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, n’est rien d’autre que l’affirmation de l’ambition coloniale du pouvoir néo-ottoman qui dirige aujourd’hui la Turquie. L’enclave kurde d’Afrin, occupée depuis février 2018, en est un exemple. Depuis cette date, la Turquie a modifié la démographie de ce territoire, y a installé des Arabes à la place des Kurdes et y a créé une administration turque. Enseignement, banque, poste, université, etc., tout a été « turquisé ».
Un Kurdistan irakien fédéral malgré la Turquie
Au début de 2003 lorsque les États-Unis et leurs alliés ont envahi l’Irak, la Turquie s’y est opposée. Contestant le projet de Washington d’un futur Irak fédéral, Ankara n’a pas autorisé l’utilisation de la base militaire d’Incirlik, dans le Sud de la Turquie, ni le déploiement des soldats américains sur son territoire. Cela a entamé la confiance entre les deux alliés, ce qui a eu pour conséquence de priver la Turquie d’une place à la table des négociations après la chute de régime de Saddam Hussein. Depuis ce moment, Ankara a constamment saboté les perspectives d’apparition d’un nouvel Irak fédéral dans lequel les Kurdes seraient autonomes. Sous prétexte de « lutte contre le terrorisme », l’armée turque mène des opérations contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et des paramilitaires sont lancés contre les dirigeant·e·s kurdes irakien·ne·s.
Lorsque la guerre civile a éclaté en Syrie en avril 2011, la Turquie, tirant les leçons de sa politique irakienne, n’a pas hésité à s’engager et à mener une guerre par procuration, notamment dans les régions au Nord du pays. Ankara a alors apporté un soutien militaire et politique aux groupes islamiques sunnites partisans d’Al Qaida et de l’État islamique opposés à Bachar al-Assad. Aujourd’hui, ce sont des milices formées par Ankara dans « l’armée nationale » qui mènent les opérations pour mettre un terme à l’administration autonome et multiculturelle du Rojava.
Retour au chaos
L’invasion turque du Nord de la Syrie n’aura pas pour seule conséquence le retour des djihadistes de Daesh. Le remplacement démographique est une arme de destruction que l’Empire turco-ottoman a toujours utilisé dans son histoire. La république turque a ensuite repris cette habitude en l’utilisant contre les Grec·que·s, les Bulgares, les Arménien·ne·s et dans la partie occupée de Chypre depuis 1974. Les projets de modification démographique par la déportation de la population kurde mèneront la région à une grande crise politique et humanitaire. L’élimination d’Al Bagdadi, le leader de l’État islamique, près d’Idlib, à 5 km à la frontière turque, n’a pas fait disparaître miraculeusement le danger du terrorisme djihadiste. Le contrôle par les forces russo-turques d’une zone longue de 120 km et large de 30 km à l’intérieur du territoire syrien a fait entrer la région dans une nouvelle phase de déstabilisation. Or, au lieu de viser une stratégie politique néo-coloniale en Syrie et en Irak, la Turquie devrait répondre tout d’abord aux revendications culturelles, politiques de ses propres kurdes. Plusieurs dirigeant·e·s kurdes élu·e·s légalement sont incarcérés suite à des procès absurdes, en plus des 10’000 prisonnières·ers politiques en Turquie accusé·e·s de « terrorisme » ou de « propagande terroriste ».
Aujourd’hui, les démocraties occidentales ont une responsabilité politique et morale de protéger les Kurdes, qui ont été des alliés déterminants contre Daech. Pour cela, il faut créer une « no fly zone » au Nord de la Syrie, y apporter de l’aide humanitaire et y installer des casques bleus afin de protéger la population civile.
Ihsan Kurt
Président de l’AFKIV
Ancien journaliste kurdo-suisse, Conseiller communal PS à Prilly,
Article paru dans le journal Pages de gauche, le 5 novembre 2019