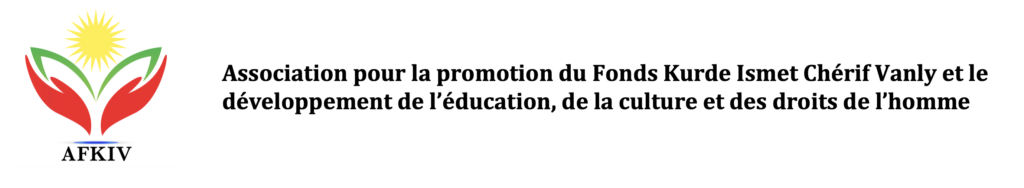Cet ancien ambassadeur de Mustapha Barzani, aujourd’hui membre du parlement kurde en exil, ne s’est jamais laissé anesthésier par la tranquillité lausannoise
Le vieil homme n’attend pas que ses visiteurs soient assis pour brandir la couverture du Times exhibant la stature colossale d’Öcalan, mains liées, yeux bandés. «C’est une insulte aux droits de l’homme!» tonne-t-il. Ses doigts tremblent. «Quand Rome capturait un chef, on le promenait dans une cage. Maintenant, les cages sont devenues des journaux et des télévisions.» Avec ses cheveux blancs clairsemés, ses gestes raffinés, Ismet Cheriff Vanly a l’air d’un enfant fragile que l’âge aurait marqué trop rapidement. La révolte ne parvient pas à occulter la douceur des traits de ce Kurde de 75 ans, membre du parlement kurde en exil établi depuis cinquante ans en Suisse. Une femme veille sur lui avec la fierté et la bienveillance d’une lionne.
D’un coup sec, il envoie le magazine sur la table basse du salon. «Je ne fais pas partie du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Mais Öcalan est la seule personne à avoir redonné aux Kurdes un sentiment de dignité. Il est l’unique rassembleur de notre peuple.» Depuis la capture de son leader Öcalan, la cause kurde occupe le devant de la scène politique. Partout, les manifestations se succèdent. Le week-end dernier, les premiers commandos kurdes ont commencé leurs opérations militaires en Turquie. «Certains médias ne voient en nous que des terroristes menaçant l’Occident», poursuit Vanly, enflammé.
A côté de sa vie tranquille dans la capitale vaudoise comme professeur d’histoire à la faculté, Ismet Vanly n’a jamais cessé de combattre pour la cause kurde. Ni sa condamnation à mort en Syrie ni l’assassinat auquel il a miraculeusement échappé n’ont freiné sa détermination.
Tandis que le vieil homme gronde, la petite femme tournoie autour de lui, appuyant ses dires. De ses yeux sombres, elle balaie l’espace du petit appartement dans lequel le couple reçoit. Un décor simple et coquet. Au milieu de la pièce, une table ronde recouverte d’une nappe et de la vaisselle blanche signifient au visiteur qu’il est attendu. Sur les étagères bourrées de livres, beaucoup de photos encadrées.
«J’ai appris le kurde ici, il y a cinquante ans», explique celui qui ouvre une brèche sur sa vie. Ne reste plus qu’à s’y laisser glisser avec la complicité de l’épouse au regard ardent. «J’étais alors ambassadeur de Mustapha Barzani (un des leaders kurdes d’Irak des années 60-70) à New York entre 1962 et 1970…» La dame amène une photo dans un cadre d’argent. «Les voilà ensemble, c’était en 1965», glisse-t-elle. Deux hommes jeunes, enturbannés, posent dans une lumière blafarde.
«A la maison, on parlait l’arabe. Mes parents ne nous ont jamais parlé kurde.» Nous voilà transportés à Damas, dans le quartier kurde adossé à la montagne et séparé de la capitale par des hectares d’abricotiers. «Des milliers d’abricotiers en fleur…» précise l’épouse, le regard brillant. «Nous, on ne se considérait pas comme des gens de Damas. Eux, c’étaient des Shâmis, ceux du Levant.»
C’est au club de foot qu’il s’initie au nationalisme. «Les chefs des mouvements kurdes étaient venus se réfugier en Syrie après la révolte de l’Ararat, en 1931. Dès mon adolescence, je les fréquentais dans les cafés de Damas. Mon père était colonel. Il ne voyait pas du tout ça d’un bon œil.» Etudes à Beyrouth, puis à Lausanne. «Je me suis tout de suite senti à l’aise ici. Je ne ressemble pas aux Orientaux. Même quand j’étais à Damas, je n’aimais pas le va-et-vient familial. Ma femme est Suissesse mais elle est tout le contraire de moi. Elle bavarde avec tous les voisins.»
La lumière du soleil couchant caresse la jolie table autour de laquelle se savoure une tourte aux pommes. «En 1965, j’étais condamné à mort en Syrie… J’ai toujours dit que la guérilla dans les montagnes entraînerait un génocide. Nous n’avons pas les moyens de soutenir une guerre comme nos grands-pères. On ne doit pas avoir une mentalité de forteresse assiégée. Pour se libérer, il faut s’attaquer aux symboles de l’Etat, aux industries, avec des cibles bien choisies. Il suffit de quelques petites cellules de quatre ou cinq personnes, avec de petites logistiques. Quelques centaines de personnes au total, qui ne se connaissent pas et qui frappent. Si le gouvernement ne fait pas son devoir, à nous de faire justice.» Ismet Vanly ne serait-il pas en train d’expliquer comment on met sur pied des attentats? Les mots passent.
«Vous savez qu’on a essayé d’assassiner mon mari? lance soudain la dame. Je n’oublierai jamais les yeux du tueur. Raconte, Ismet!» L’époux s’exécute: «C’était en 1976. Saddam Hussein avait envoyé son cousin Tikriti, ambassadeur à Genève. Il est venu avec un soi-disant diplomate. J’avais invité deux amis kurdes médecins. Tikriti m’a dit alors: «Je suis ton frère, arrête d’insulter le gouvernement.» En partant, il m’a dit: «Je t’enverrai des dattes de chez nous.» Trois jours plus tard, l’autre est revenu. C’était midi. En ouvrant, je l’ai vu avec ses dattes dans un sac en nylon. Je lui ai tout de suite dit: «Je ne veux pas de tes dattes.» Mais, vous savez, l’hospitalité… Je l’ai fait entrer, je lui ai demandé ce qu’il voulait boire. «Un café», m’a-t-il répondu. Je n’avais qu’une envie: qu’il parte. Quand j’ai tourné le bouton de la cuisinière, ma tête a vibré. J’ai vu le sang couler. Et j’ai pensé: quelle honte que mon sang coule comme ça, devant un étranger. Je me suis retourné et je l’ai vu s’enfuir. J’ai alors appelé le 117, aucun son ne sortait de ma bouche. Je n’avais toujours pas compris. Je croyais que j’avais reçu une secousse électrique de la cuisinière. Je suis allé sonner chez les voisins. Là tout est allé très vite. En attendant l’ambulance, j’ai rangé mon manuscrit et j’ai pris un peu d’argent. J’ai perdu connaissance juste avant d’arriver à l’hôpital. En ouvrant les yeux, la première chose à laquelle j’ai pensé, c’était à la cuisinière. Je voulais avertir Carmen pour qu’elle n’y touche pas. On m’a dit que j’avais reçu deux balles dans la nuque.»
Depuis, la famille vit sous un faux nom. Et, chaque fois qu’elle reçoit un visiteur, le fils est dans les parages, avec son chien.
Article paru dans le journal Le Nouveau Quotidien,
le 10 mars 1999