On dirait que le tabou kurde se brise en Turquie. Ce printemps, nous avons découvert que les services secrets turcs rencontraient régulièrement le chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), Abdullah Öcalan, emprisonné depuis quatorze ans sur l’île d’Imrali (en mer de Marmara). Ces rencontres sont devenues publiques et, le 21 mars dernier, jour du Nouvel An kurde, le message du leader kurde a été adressé à la foule à Diyarbakir: la fin de la lutte armée. Un espoir pour la paix et la démocratie pour certains, un «deuxième Lausanne» pour d’autres, qui se méfient d’Ankara. C’est que le Traité de Lausanne de 1923 a influencé profondément le destin des Kurdes.
L’histoire nous parle de vingt-neuf révoltes populaires kurdes depuis le 24 juillet 1923, date de la signature du Traité de Lausanne (lire ci-contre). Le récit national présente la guérilla du PKK, lancée en 1984, comme la 29e révolte contre Ankara. Depuis avril 1993, le mouvement kurde a recouru huit fois à un cessez-le-feu unilatéral. Après l’arrestation d’Öcalan, la question a pris une autre orientation: les négociations avec le gouvernement, l’abandon de l’idéologie marxiste-léniniste et la revendication des droits culturels, au lieu de l’indépendance. Le gouvernement turc est satisfait du retrait des insurgés de son territoire mais il n’a pas une politique convaincante. Certes, la question kurde est aujourd’hui discutée quasi ouvertement en Turquie dans toute sa complexité politique et idéologique. Néanmoins, le gouvernement islamo-conservateur a arrêté plus de 10 000 personnes depuis 2009, parmi lesquelles se trouvent des députés, des
intellectuels, et des militants pacifistes.
La dimension internationale du problème kurde est aussi complexe. La Turquie concentre la moitié des Kurdes divisés entre quatre Etats de la région (Iran, Irak, Syrie, Turquie). La crainte du sécessionnisme kurde est l’un des aspects du «syndrome de Sèvres» persistant dans certains cercles nationalistes du pouvoir turc. Les Kurdes d’Irak disposent depuis 2003 d’une large autonomie et ceux de la Syrie y aspirent également. Les «printemps arabes» qui bouleversent les régimes totalitaires et répressifs de la région obligent aussi la Turquie de résoudre son problème kurde. Et la présence de la diaspora kurde en Europe a toujours compliqué les relations d’Ankara avec les capitales européennes. Plus de 1 million de Kurdes vivent en Europe, les deux tiers en Allemagne et environ 80 000 en Suisse. Ces émigrés kurdes sont très politisés et militent activement depuis le milieu des années 1980 pour la reconnaissance de leurs droits en Turquie. Le mouvement national kurde trouve un fort appui politique et économique auprès de ces communautés, qui dénoncent les politiques répressives d’Ankara auprès des opinions européennes.
Même si, d’une part, la conjoncture régionale et, d’autre part, l’Union européenne poussent Ankara à dédramatiser la question kurde, le gouvernement de Tayyip Erdogan n’a pas de projet concret. De plus, le Premier ministre, qui est connu pour sa rhétorique populiste à l’attention des Turcs et provocatrice à l’égard des Kurdes, proférait en août 2008 à Diyarbakir que la Turquie connaît «une seule nation, un seul drapeau, une seule langue et un seul Etat» et que «ceux qui ne sont pas d’accord avec ce principe peuvent quitter le pays». Ce qui a entraîné des émeutes dans cette ville. Le lancement d’une chaîne nationale de télévision en langue kurde, TRT6, en janvier 2009, a été perçu comme anecdotique par les Kurdes. Suite aux pressions d’Ankara, Copenhague vient d’interdire les émissions de trois chaînes kurdes diffusant depuis le Danemark.
Depuis la fondation de la république kémaliste, les Kurdes, considérés comme un danger pour l’unité et l’identité nationale turque, ont été pris dans un processus d’assimilation centralisateur. Ce qui les a poussés à devoir choisir entre marginalisation et révoltes. Composant plus de 20% (sur 75 millions d’habitants) de la population de Turquie, ils ne sont pas reconnus dans leurs spécificités par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. Dans le récit nationaliste turc sur ce traité, le mouvement nationaliste, issu de l’Empire ottoman vaincu durant la Première Guerre mondiale, se présente brillamment sous le commandement du héros Mustafa Kemal. Il a défié les impérialistes dans une «guerre de libération» de 1919 à 1922. Il a également remporté la victoire contre les «traîtres grecs, arméniens et kurdes». Il pose ainsi les fondements de l’homogénéité nationale.
Comme l’écrit l’historien suisse Hans Lukas Kieser, «le Traité de Lausanne est un jour de gloire ou de deuil, de triomphe ou d’humiliation. C’est pourquoi ses retombées se font toujours sentir dans les rues de Lausanne». Chaque année, des milliers de Kurdes provenant de toute la Suisse crient leur slogan dans les rues de cette ville: «Nous ne reconnaissons pas le Traité de Lausanne».
Le gouvernement turc devrait agir clairement dans deux directions pour convaincre les Kurdes de sa bonne foi. Sur un axe politico-économique, il faut traiter de façon adéquate le retour des réfugiés et la restitution de leurs biens matériels, la libération de plus des 10 000 prisonniers politiques arrêtés depuis 2009 et l’abolition d’un système électoral qui empêche les Kurdes d’être représentés démocratiquement au parlement turc. Le deuxième axe est constitutionnel, pour envisager une nouvelle définition de la citoyenneté, multiethnique et multiconfessionnelle.
Après nonante ans, Lausanne n’est donc pas un traité à réviser, mais à surmonter: par l’émancipation véritable d’un ethnonationalisme antihumaniste, entretenu par un Etat qui a persisté à se voir menacé de démembrement par ses propres citoyens. Dans le contexte international et la conjoncture régionale d’aujourd’hui, le Traité de Lausanne est devenu un habit étroit et démodé, qui ne sied plus à la Turquie.
* Président de l’Association pour le fonds kurde Ismet Chérif Vanly (AFKICV). L’association a organisé une conférence débat le 22 juin dernier à Lausanne avec des intervenants académiques et politiciens suisses et kurdes.
Comme chaque année, la communauté kurde de Suisse manifestera contre le Traité de Lausanne, ce samedi 27 juillet à 14 h, place de la Riponne, à Lausanne. Cette action est organisée par la FEKAR (Fédération des associations culturelles du Kurdistan), qui compte 13 associations en Suisse.
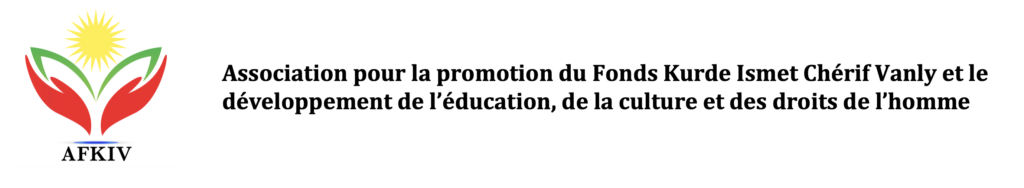





Commentaires récents